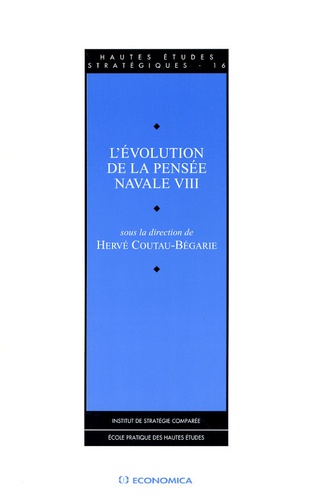Paris, Carrousel du Louvre, 8 et 9 juin 1995
Table des matières
Message de M. Jacques Chirac, président de la République
Allocution inaugurale présidée par M. Bernard Dufour, président-directeur général de Snecma
Commémoration des Anciens du « Groupe O »
Allocution de M. le professeur Cyrill von Gersdorff, adjoint d’Herman Oestrich, « Groupe O » intégré dans la Snecma en 1950
Allocution inaugurale par M. Henri Conze, délégué général pour l’armement
Histoire des moteurs d’aviation français
Les moteurs d’aviation : une industrie stratégique
par M. Claude Carlier, professeur à la Sorbonne, directeur du Centre d’histoire de l’aéronautique et de l’espace
Des débuts à la fin de la Première Guerre mondiale
par M. Guy Dodanthun, ancien directeur financier de Snecma
De 1920 à la fin de la Seconde Guerre mondiale
par M. Michel Harvey, délégué général de Snecma au Royaume-Uni
De la naissance de Snecma à 1970
par M. François Roudier, historien de l’aéronautique, Snecma
par M. Yves Bonnet, vice-président de Snecma
Débats avec la participation de M. Michel Weck, responsable central des archives Snecma
Les moteurs militaires
Les réacteurs Snecma M 53 et M 88
par M. Alain Habrard
Les réacteurs Rolls Royce RB 199 et EJ 200
par M. Philip Wilkins
Les réacteurs Pratt & Whitney F 100 et F 119
par M. Walter N. Bylciw
Les réacteurs General Electric F 110 et F 404
par M. Dennis K. Williams
Débats avec la participation de M. Jean-Pierre Casamayou
Les moteurs civils
Les Snecma/General Electric CFM 56-3, -5 et -7
par M. Pierre Alesi
Les General Electric CF 6 et GE 90
par M. Charles L. Chadwell
Les Pratt & Whitney PW 2000 et PW 4000
par M. Robert F. Leduc
Les Rolls Royce V 2500 et les RB 211/Trent
par M. Daniel Wicks
Débats avec la participation de M. Pierre Condom
Moteurs et Equipements
par M. Jean Bernard Cocheteux
par M. Raymond Poggi
par M. Luigi Torricone
par M. Hanns-Jürgens Lichtfuss
Débats avec la participation de M. Michel Polacco
Les moteurs du XXIe siècle
par M. Robert E. Henderson
par M. John A. R.Chisholm
par M. Paul Kuentzmann
Débats avec la participation de M. Stanley W. Kandebo
Table ronde sur la stratégie des motoristes aéronautiques
Avec la participation de :
M. Gérard Jouany, AJPAE
M. Bernard Dufour, Snecma
M. Robert A. Wolfe, Pratt & Whitney
M. Brian Rowe, General Electric Aircraft Engines
M. John Rose, Rolls-Royce plc
M. Bruno Revellin Falcoz, Dassault Aviation
M. Louis Gallois, Aérospatiale
M. Adam Brown, Airbus Industrie
M. Richard Albrecht, Boeing Commercial Airplane Group
– – –
Séance de clôture présidée par M. Bernard Dufour
Allocution de clôture par Mme Anne-Marie Idrac
Secrétaire d’Etat aux Transports